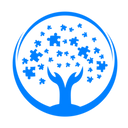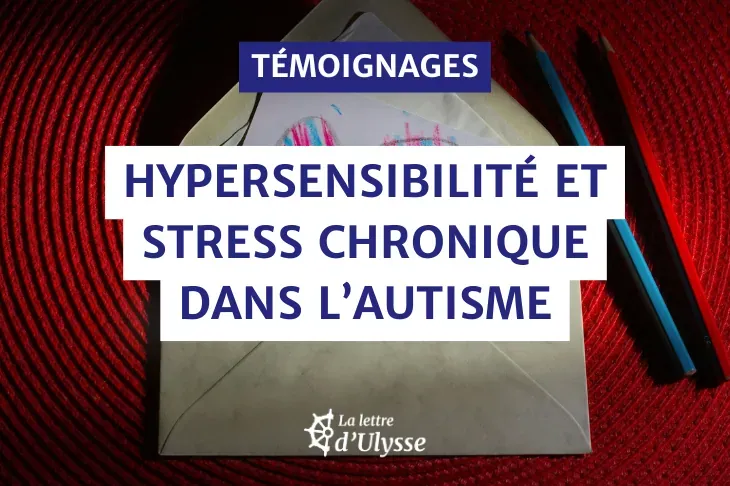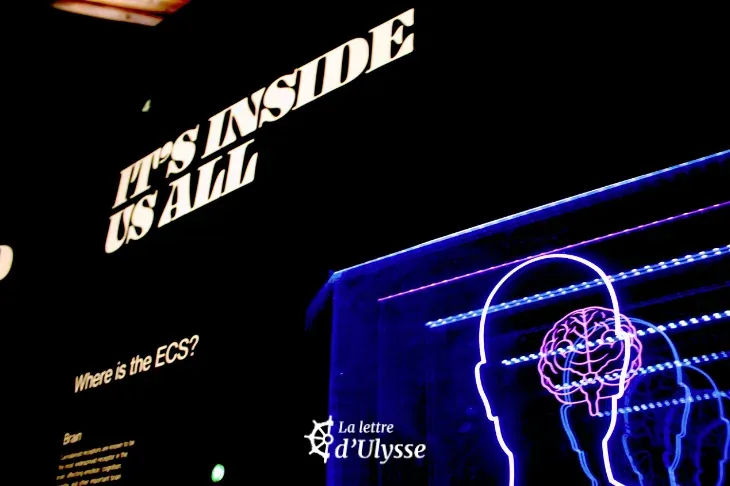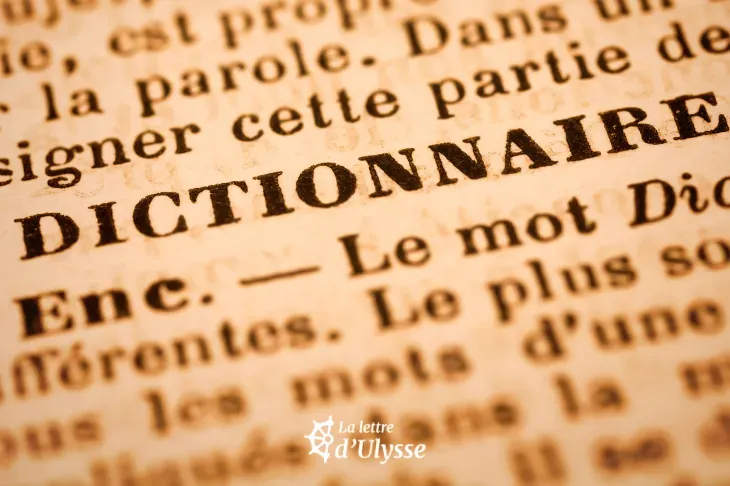6 clés pour décoder le monde sensoriel de votre enfant autiste
Que recouvrent les "particularités sensorielles" très souvent évoquées dans le trouble du spectre de l'autisme (TSA) ?

Table des matières
Si vous découvrez le sujet des troubles sensoriels dans l'autisme, ces deux vidéos de la plateforme 2 minutes pour mieux vivre l'autisme constituent une première introduction simple au sujet :
Depuis 2013 (et le DSM 5), les troubles sensoriels sont intégrés aux critères de diagnostic des troubles du spectre de l'autisme (TSA).
Pas le temps de tout lire ? Ce qu'il faut retenir.
- Les troubles de l'intégration sensorielle perturbent le "filtre" du cerveau, qui ne trie plus correctement les informations importantes de celles qui ne le sont pas, créant une surcharge permanente.
- Chaque enfant peut être hypersensible à certains sens et hyposensible à d'autres, voire les deux selon les moments, ce qui explique des comportements apparemment contradictoires comme fuir les tobogans mais adorer tourner sur soi.
- Les "crises" (meltdown) et replis (shutdown) sont des réponses neurologiques à la surcharge sensorielle, pas des caprices - le système nerveux s'effondre ou se protège en coupant tout.
- Observer et noter les réactions sensorielles de son enfant permet de créer son "profil sensoriel" pour mieux adapter l'environnement et comprendre ses besoins d'autorégulation.
Cet article fait partie d'une série sur les particularités sensorielles :

Et maintenant, entrons dans les détails !
1. Quelle part des personnes autistes est concernée par les troubles sensoriels ?
Selon l'étude épidémiologique la plus robuste portant sur un échantillon de 25 627 enfants autistes, publiée en 2022, environ 74% des enfants présentent des particularités sensorielles. Cette prévalence varie cependant selon les études, allant de 45% à 96%.
C'est donc une particularité très... générale dans le fonctionnement des personnes avec un TSA !
2. À la recherche des sens méconnus
Dans l'imaginaire collectif, nous avons "cinq sens". Cette perception s'avère très limitative quand on s'intéresse aux particularités sensorielles de l'autisme. En réalité, selon les classifications scientifiques, nous pouvons avoir de sept à huit sens principaux, voire jusqu'à 22 selon certaines approches plus détaillées. On préfère aujourd'hui parler de canaux sensoriels car cela reflète mieux la complexité de notre système de perception de l'environnement.
Les cinq sens "classiques"
Bien sûr, nous connaissons tous :
- La vision : faculté de voir.
- L'audition ou ouïe : faculté de perception des sons.
- L'olfaction ou odorat : faculté de sentir odeurs et parfums.
- Le goût : faculté de perception des saveurs des substances par la bouche et la gorge.
- Le système tactile ou toucher : faculté de percevoir le toucher, la pression, la douleur externe, la température.
Deux sens essentiels mais méconnus
Deux autres canaux sensoriels sont moins connus mais tout aussi importants.
- Le système vestibulaire
C'est notre sens de l'équilibre et du mouvement. Des récepteurs situés dans notre oreille interne envoient des informations sur la direction et la vitesse de nos mouvements et déplacements. Ce système nous permet d'ajuster la position de notre corps dans l'espace en tenant compte de la gravité. Il contribue à notre équilibre et à notre tonus musculaire, et agit toujours avec au moins un autre sens, surtout la vue ou la proprioception.
Dans l'autisme, des troubles vestibulaires expliquent pourquoi certains enfants refusent catégoriquement les tobogans ou deviennent nauséeux en voiture, mais adorent tourner sur eux-mêmes. Cette recherche apparemment contradictoire s'explique par le contrôle : ils fuient les mouvements imprévisibles mais recherchent ceux qu'ils maîtrisent, dans une logique de stimulation.
Recevez gratuitement
La lettre d'Ulysse
Toutes les deux semaines, comme plus de 3 000 abonnés, recevez directement par mail une sélection d’infos claires et pratiques pour mieux comprendre les besoins particuliers des enfants autistes et y répondre.
- La proprioception : notre "GPS" corporel
Ce mécanisme transmet à notre cerveau des informations provenant des muscles, articulations, ligaments et os. La plupart du temps, nous n'en sommes pas conscients, mais c'est ce qui nous fait sentir la position de chacune des parties de notre corps. Il nous permet de nous orienter dans l'espace, de planifier et d'exécuter des mouvements.
Quelques exemples concrets de l'utilisation de la proprioception: vous arrivez à monter un escalier sans regarder vos pieds, à vous brosser les cheveux sans vous regarder dans un miroir, ou encore dans une pièce sombre, à savoir approximativement où se trouve l'interrupteur grâce à votre proprioception, sans avoir besoin de voir ou de tâtonner partout.
Le besoin irrépressible de sauter ou de se serrer très fort contre nous de certains enfants autistes s'explique : ils cherchent à "nourrir" ce sens proprioceptif défaillant. Ces comportements de stimulation sensorielle ne sont pas des caprices mais des tentatives d'autorégulation.
- L'intéroception : un "huitième sens" méconnu et pourtant crucial
L'intéroception est notre « tableau de bord interne » : rythme cardiaque et respiratoire, sensations de faim, de soif, besoin d'aller aux toilettes, niveau de fatigue, de stress.
Cette difficulté intéroceptive touche particulièrement les personnes autistes, avec des conséquences concrètes multiples :
- Ne pas sentir qu'on a faim jusqu'à l'hypoglycémie, ou au contraire manger sans s'arrêter
- Ne pas percevoir l'envie d'uriner ou la percevoir trop tardivement
- Ne pas reconnaître la fatigue, ce qui peut mener à l'épuisement
- Difficultés à identifier les émotions, car elles s'accompagnent de sensations corporelles (cœur qui bat, ventre noué, etc.)
- Problèmes de régulation émotionnelle, l'intéroception étant liée à la gestion du stress et de l'anxiété
Certains comportements apparemment inexplicables prennent soudain sens : la crise "sans raison" peut être liée à une faim non perçue, l'agitation peut masquer un besoin urgent d'aller aux toilettes.
- D'autres modalités sensorielles
Selon les classifications, on trouve aussi d'autres modalités sensorielles :
- La nociception : la perception de la douleur. Chez certaines personnes autistes, elle peut être altérée, expliquant pourquoi elles peuvent se blesser sans s'en apercevoir ou au contraire réagir de façon disproportionnée à une douleur mineure.
- La thermoception : la perception des variations de température. Les difficultés de thermorégulation sont fréquentes dans l'autisme.
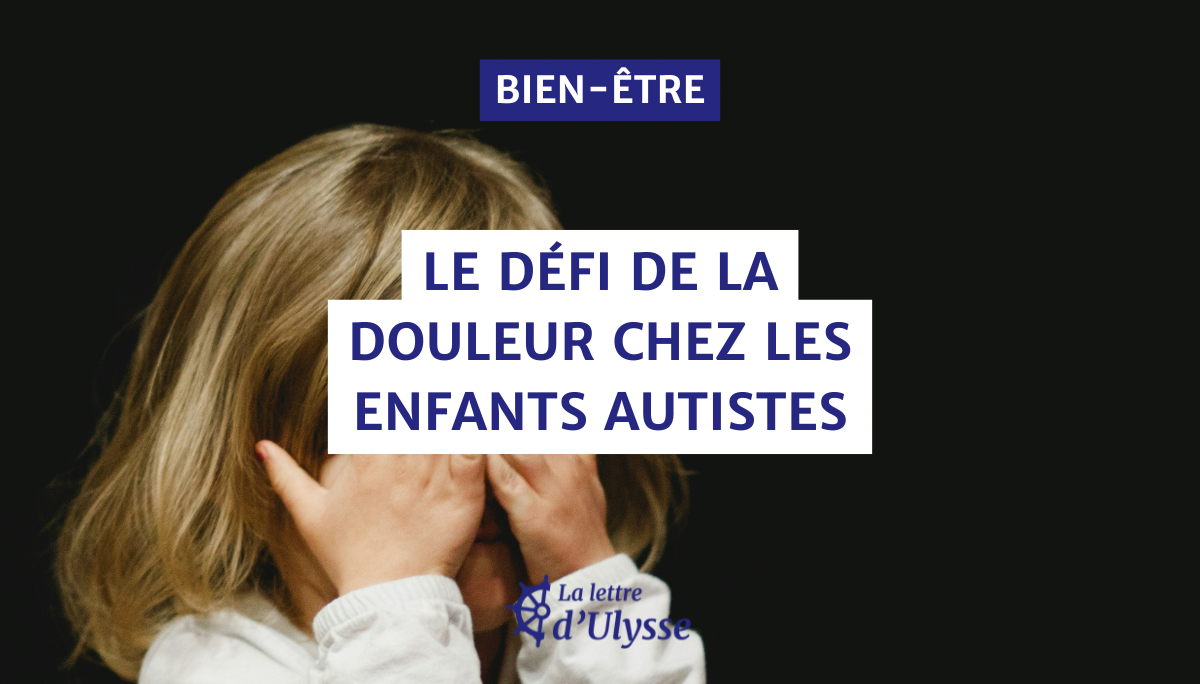

Une explication du rapport particulier des personnes autistes à leur corps
Cette vision élargie des canaux sensoriels éclaire certains comportements que nous observons chez nos enfants. "Faire travailler ensemble les diverses parties de son corps constitue une tâche monumentale" explique Temple Grandin, l'une des porte-voix de l'autisme.
Les difficultés à utiliser l'information provenant du toucher, de la proprioception et du système vestibulaire génèrent des difficultés de coordination motrice. La personne perçoit son corps de manière incomplète et l'utilise maladroitement quand elle apprend de nouveaux mouvements.
Les difficultés à se tenir debout en s'habillant, la maladresse pour attraper un ballon, le besoin irrépressible de bouger pour mieux se concentrer, ou encore ces "crises" qui surviennent apparemment sans raison mais qui peuvent masquer un inconfort intéroceptif non identifié.
3. Comment marchent (plus ou moins bien) nos systèmes sensoriels ?
Sensorialité, modulation sensorielle, troubles de l'intégration sensorielle... Vous êtes perdu ? Une petite clarification sur le fonctionnement de nos systèmes sensoriels s'impose pour mieux comprendre les causes des perturbations que connaissent les personnes autistes.
Le traitement sensoriel (en très bref)
D'abord les récepteurs sensoriels (yeux, oreilles, peau...) captent l'information de l'environnement et la transforment en signaux électriques. Puis le cerveau analyse et met en forme ces informations brutes pour les rendre utilisables. Enfin, il les interprète et leur donne du sens pour décider d'une réponse adaptée. C'est ce qu'on appelle le traitement sensoriel. L'ensemble de ce processus peut être perturbé dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme (TSA)
L'intégration sensorielle
Ce qui pose particulièrement problème dans l'autisme, ce n'est pas la captation de l'information -les sens font le job- c'est la manière dont le cerveau traite et organise ces informations sensorielles qui lui arrivent en permanence.
Imaginez le cerveau comme un chef d'orchestre qui doit coordonner simultanément tous les musiciens : c'est l'intégration sensorielle, ce processus naturel par lequel notre cerveau reçoit, trie et organise les informations de nos sens pour nous permettre de réagir de façon adaptée.
Quand ce processus fonctionne bien, nous pouvons nous concentrer sur une conversation dans un restaurant bruyant, marcher sans trébucher, ou ignorer le contact de nos vêtements sur notre peau. Ces capacités qui nous semblent évidentes nécessitent en réalité une coordination remarquable de notre système nerveux.
Les troubles de l'intégration sensorielle
Sauf que ce chef d'orchestre a parfois du mal à faire jouer tout le monde en harmonie. On parle alors de troubles de l'intégration sensorielle : des difficultés du système nerveux à filtrer, organiser et répondre de manière adaptée aux informations sensorielles.
La modulation sensorielle : le filtre défaillant
Au cœur de ces difficultés se trouve la modulation sensorielle, le système de filtrage de notre cerveau qui trie les informations importantes de celles qui ne le sont pas.
Ce système repose sur deux mécanismes complémentaires :
- L'habituation : qui diminue notre réaction aux stimuli familiers (ne plus entendre le bruit de fond du réfrigérateur)
- La sensibilisation : qui amplifie notre attention aux stimuli importants (entendre son prénom dans une foule)
Quand ce système dysfonctionne, la personne autiste peut se retrouver submergée par un flot d'informations non filtrées. Par exemple, un élève autiste en classe peut avoir du mal à se concentrer car il est dérangé par tout ce qui se passe autour : bavardages, grésillement du néon, bruit du ventilateur.
Tous ces stimuli sont traités au même niveau, sans hiérarchisation ni tri préalable.
Recevez gratuitement
La lettre d'Ulysse
Toutes les deux semaines, comme plus de 3 000 abonnés, recevez directement par mail une sélection d’infos claires et pratiques pour mieux comprendre les besoins particuliers des enfants autistes et y répondre.
4. Naviguer entre "hypo" et "hyper" sensibilité
L'image spontanée la plus fréquente en termes de particularités sensorielles dans l'autisme, c'est l'hypersensibilité (par exemple, par rapport au bruit, à certaines matières). En fait, ce n'est qu'une dimension du problème.
Le seuil de perception : ces curseurs dérégulés
La clé de compréhension réside dans une notion fondamentale : le seuil de perception. C'est la plus petite intensité d'un stimulus capable de provoquer une sensation. Imaginez-le comme un curseur de volume, mais pour chacun de vos sens.
Chez une personne neurotypique, ce curseur est généralement réglé de manière équilibrée. Mais dans l'autisme, ces seuils peuvent être complètement déréglés. Et c'est là que tout se complique.
Quand le curseur est réglé trop bas : l'hypersensibilité
L'hypersensibilité correspond à un seuil d'excitation trop bas. Le canal sensoriel est "trop ouvert" : trop de stimulations arrivent pour être traitées correctement. La personne hypersensible va recevoir trop d'informations et se sentira submergée, agressée.
Concrètement, cela donne des situations comme :
- Hypersensibilité auditive : se boucher les oreilles quand on allume l'aspirateur, car ce bruit quotidien devient littéralement douloureux.
- Hypersensibilité tactile : l'étiquette du t-shirt devient insupportable, comme si elle "gratouillait" constamment.
- Hypersensibilité visuelle : les néons du supermarché agressent au point de devoir fermer les yeux.
Le système neuronal est surinvesti, ce qui rend la personne consciente des moindres stimuli sans disposer de capacités suffisantes d'habituation.
Quand le curseur est réglé trop haut : l'hyposensibilité
À l'opposé, l'hyposensibilité correspond à un seuil d'excitation trop élevé. Le canal sensoriel n'est "pas assez ouvert" : trop peu de stimulations arrivent au cerveau. Il faut un niveau de stimulation important pour déclencher une réponse.
Les manifestations sont alors radicalement différentes :
- Hyposensibilité tactile : se brûler sans ressentir la douleur, ne pas réagir aux blessures.
- Hyposensibilité auditive : avoir tendance à crier ou faire du bruit pour se procurer des stimulations auditives.
- Hyposensibilité vestibulaire : avoir besoin d'être constamment en mouvement, sauter, tourner sur soi-même.
Les enfants concernés sont alors en recherche de sensations fortes et éprouvent un important besoin de stimulation, qui peut générer des comportements à risque. Ils peuvent sembler léthargiques ou apathiques car les stimuli sont insuffisants pour les maintenir dans un état optimal ou pratiquer des formes d'autostimulations qui peuvent sembler compulsives.
On peut être hyper ET hypo
Voici ce qui complique encore tout : une personne peut être hypersensible à certains sens et hyposensible à d'autres. Voire connaître des variations au sein d'une même modalité sensorielle.
Un enfant peut donc être hypersensible aux bruits (il se bouche les oreilles) ET hyposensible au niveau proprioceptif (il a besoin de sauter partout pour sentir son corps). Ces fluctuations sensorielles peuvent même coexister selon les moments, le niveau d'éveil, le contexte. Ou même au cours de la vie, avec des évolutions notables à l'adolescence.
Une étude indique que 67% des enfants autistes présentent ce profil mixte d'hypo et d'hypersensibilité selon le contexte. Ce n'est donc pas l'exception, mais bien la norme.
Les stratégies d'adaptation : quand l'enfant devient son propre thérapeute
Face à ces déréglages sensoriels, nos enfants développent instinctivement des stratégies d'adaptation. Le modèle de Dunn distingue quatre profils selon que l'enfant adopte une attitude passive ou active face à ses seuils :
- L'évitement : l'enfant hypersensible cherche à limiter les stimulations vécues comme insupportables
- L'hyperréactivité : submergé par les informations, il devient distractible et hyperactif
- L'hyporéactivité : l'enfant hyposensible donne l'impression d'apathie car son cerveau ne capte pas les signaux importants
- La stimulation sensorielle : l'enfant tente de se créer des sensations pour atteindre son seuil élevé de sensibilité.
Ces comportements, que nous pouvons parfois interpréter comme "difficiles", sont en réalité des tentatives d'autorégulation parfaitement logiques au regard du fonctionnement sensoriel atypique des personnes TSA.
4. Quand le système craque : shutdown et meltdown
L'aboutissement logique de la surcharge sensorielle
Mais parfois, le système nerveux des personnes autistes atteint ses limites absolues. C'est alors que surviennent deux phénomènes que tous les parents d'enfants autistes connaissent : le meltdown (qu'on peut traduire par effondrement) et le shutdown (l'extinction, ou de façon plus imagée, "le baisser de rideau").
Ces "craquages" ne sortent pas de nulle part. Ils sont l'aboutissement logique de tout ce que nous venons d'explorer : accumulation de stimuli non filtrés, épuisement des stratégies d'autorégulation, dépassement des seuils de tolérance.
Meltdown : l'explosion du système
Le meltdown, c'est l'explosion. L'enfant semble perdre tout contrôle : cris, pleurs, agitation extrême, parfois automutilations. Son système nerveux, complètement submergé par l'afflux d'informations sensorielles, déclenche cette réaction neurologique involontaire.
Ce n'est pas un caprice, mais une réponse de survie du cerveau face à la surcharge.
Shutdown : la protection par l'extinction
Le shutdown représente la stratégie inverse : l'enfant se "ferme", devient apathique, ne répond plus. C'est le mécanisme d'autoprotection ultime. Quand le système ne peut plus filtrer, il coupe tout. L'enfant peut sembler absent, avoir le regard dans le vide, chercher l'isolement dans un coin sombre et calme.
Comment réagir ?
Pendant un meltdown : assurer la sécurité, réduire les stimuli sensoriels, éviter de raisonner (le cerveau ne peut pas traiter ces informations), rester calme et présent.
Pendant un shutdown : respecter le besoin de retrait, offrir un environnement sensoriel neutre, attendre patiemment le "redémarrage" du système.
L'accumulation invisible de la "charge sensorielle"
Ces phénomènes révèlent un aspect crucial : la "charge sensorielle" s'accumule tout au long de la journée. L'enfant peut très bien supporter un stimulus le matin et exploser face au même stimulus le soir.
Cette accumulation explique pourquoi ces crises semblent parfois disproportionnées par rapport au déclencheur apparent.
Les signaux d'alerte à reconnaître
Avec l'expérience, certains signaux précurseurs de surcharge sensorielle en devenir deviennent identifiables :
- Augmentation des stéréotypies
- Hypersensibilité accrue aux stimuli habituels
- Irritabilité croissante
- Fatigue marquée dans les environnements stimulants sensoriellement.
Après la tempête : une nécessaire récupération
Ces épisodes laissent l'enfant épuisé, comme si son système nerveux avait utilisé toute son énergie disponible. Cette phase de récupération est essentielle et peut durer plusieurs heures.
Prévenir plutôt que subir
La meilleure stratégie reste la prévention : observer les signaux précurseurs, proposer des pauses sensorielles régulières, adapter l'environnement selon la charge sensorielle accumulée. Les stratégies d'anticipation, comme l'utilisation de supports visuels, peuvent préparer les enfants autistes à des situations stressantes sur le plan sensoriel.
Comprendre que meltdowns et shutdowns sont des réponses logiques à une surcharge sensorielle transforme notre approche : de la gestion de crise, nous passons à la prévention bienveillante, guidée par la compréhension des besoins sensoriels réels.
5. De la théorie à l'action : créer la boussole sensorielle de votre enfant
Le profil sensoriel
Vous êtes maintenant bien outillé pour dresser le portrait sensoriel unique de votre enfant. Lorsque ce "portrait" est réalisé par un professionnel (ergothérapeute, psychomotricien), on parle de "profil sensoriel". Nous reviendrons prochainement sur cette notion dans un article dédié.
Connaître les spécificités sensorielles permet d'adapter l'environnement, les apprentissages et de comprendre certains comportements sous un angle nouveau, et ultérieurement, de proposer des activités ou une prise en charge adaptée.
Mais vous pouvez déjà commencer seuls !
Observer pour comprendre
Commencez par noter dans un carnet :
- Les déclencheurs : quels stimuli provoquent des réactions ?
- Les apaisements : qu'est-ce qui le calme ?
- Les recherches : quelles sensations recherche-t-il ?
- Les évitements : qu'est-ce qu'il fuit systématiquement ?
Portez attention aux moments clés : repas, sorties, hygiène, temps informels. C'est là que les particularités sensorielles se révèlent le plus clairement.
Des outils pratiques accessibles aux parents
Ces ressources peuvent également vous aider dans votre démarche accompagner :
- La feuille d'auto-évaluation des 8 systèmes sensoriels pour noter vos observations. Elle est proposée d'une trousse à outils sur les particularités d'intégration sensorielle proposée par AideCanada.
- Pour les plus ambitieux, la checklist révisée du profil sensoriel d'Olga Bodgashina est remplie par les parents de l'enfant mais doit être étayée par une observation à l'école ou en institution. Je vous recommande de lire "Pourquoi établir un profil sensoriel en autisme", sur le site d'Autisme Diffusion où cette checklist est téléchargeable afin de bien l'exploiter.
Une nouvelle grille de lecture
Ces comportements que nous pouvions interpréter comme "difficiles" révèlent des tentatives d'autorégulation parfaitement logiques. Le besoin de sauter partout ? Une recherche proprioceptive. Les crises "sans raison" ? Peut-être une surcharge sensorielle.
Cette compréhension ouvre des pistes d'accompagnement plus adaptées et bienveillantes, également développés dans cette série sur les particularités sensorielles.
Pour aller plus loin :
Voici une liste de ressources sur lesquelles je me suis appuyé et qui vous permettront d'approfondir ce sujet :
- Comprendre l'autisme : la perception sensorielle
- CRA Centre : La sensorialité, qu'est-ce que c'est ?
- CHU Sainte-Justine, Montréal : Les particularités et besoins sensoriels chez l’enfant présentant un TSA
- Hoptoys.fr : L’intégration sensorielle illustrée, un article avec des illustrations très pédagogiques, pour évoquer le sujet avec votre enfant par exemple. Hoptoys propose également un livre blanc de l'intégration sensorielle à télécharge extrêmement complet, pédagogique, et bien construit.
- Alistair Houdayer (vidéo YouTube) : Mieux comprendre l'autisme : Hypersensibilité et Troubles Sensoriels, parce que les particuliers sensorielles dans l'autisme, ce sont encore les personnes autistes qui en parlent le mieux, et que le talent d'Alistair en termes de vulgarisation est inégalé.
- Olga Bogdashina : "Questions de perception sensorielle dans l'Autisme et le Syndrome d'Asperger" est une forme de bible des particularités sensorielles dans l'autisme. C'est aussi un pavé (371 pages). J'ai préféré le plus digeste "Explorer le monde sensoriel de l'autisme", de la même autrice, plus accessible pour les parents.
- Canal U : Pour les fans de recherche scientifique, Canal U propose une série de replays d'un colloque de l'Association Française de Neuropsychologie de l'Autisme intitulé : "Particularités sensorielles dans le Trouble du Spectre de l’Autisme" (2022).